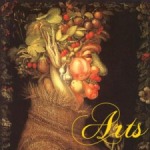Salons de Diderot : l'invention d'un style
Pour bien comprendre ce qui fait l'originalité de l'œuvre de Diderot en tant que critique, citons le jugement bien sévère que Barbey d'Aurevilly profère sur Diderot critique d'art dans Goethe et Diderot : il parle de lui comme d'« un peintre qui crevait la peinture pour passer sa tête par le trou de la toile afin qu'on le vit bien et qu'on l'entendit toujours ». Diderot aurait été critique d'art pour promouvoir sa propre parole plutôt que pour montrer la toile. Les critiques ont exploré cette idée et Jean Starobinski a soulevé le problème lorsqu'il écrit à propos de l'écriture de Diderot qu'elle :
conjugue l'extrême attention et l'infidélité désinvolte, qui réclame, d'autres images [...] et qui les esquisse à sa fantaisie. [...] La critique naît en s'attribuant la faculté d'évincer l'art, de parler à sa place.
« Évincer l'art », « parler à sa place »... : là se situe l'enjeu. L'originalité de Diderot tiendrait dans la coexistence paradoxale d'une « attention extrême » et d'une « infidélité désinvolte », c'est-à-dire d'un regard attentif, et, au lieu d'un rapport fidèle et attendu, d'images nées de la fantaisie, d'esquisses nées de l'imaginaire. La description fidèle des tableaux et sculptures vus au Salon Carré du Louvre laisse parfois place à des images qui paradoxalement « évincent » les œuvres originales : lorsque Diderot n'aime pas une œuvre, il la remplace, dans son compte-rendu, par le tableau que lui-même aurait fait...
Peut-on pour autant définir la critique de Diderot comme un évincement de l'art ? Si Diderot semble parfois parler à la place des peintures et des artistes, y a-t-il infidélité ? Et vise-t-elle à imposer une parole monologique ? Nous verrons comment paroles et images que Diderot substitue aux œuvres réelles coïncident moins avec un éloignement de l'art qu'avec une tentative, par l'écriture, de se rapprocher de l'Idée et du Beau. Ainsi, dans les Salons, Diderot passe d'un discours sur l'art à un discours d'art.
Transcrire les œuvres avec fidélité
Le salonnier s'astreint à une fidélité à l'art dans la mesure où son travail est destiné, à travers la Correspondance littéraire, à rendre visibles des peintures et des sculptures aux abonnés lecteurs.
Le lectorat n'a pas les œuvres sous les yeux : l'écriture de Diderot doit tendre à une description précise qui puisse donner à voir les œuvres absentes. « Je vous décrirai les tableaux et ma description sera telle qu'avec un peu d'imagination et de goût on les réalisera dans l'espace et qu'on y posera les objets à peu près comme nous les avons vus sur la toile » écrit-il dans le Salon de 1765. Dès 1759, il emploie des méthodes de description que Marie-Elise Bukhdal appelle « scientifique » ou « référentielle » qui visent à élaborer un double littéraire et mimétique du référent pictural. Dans le Salon de 1763, il décrit notamment Orphée descendu aux Enfers pour en ramener Euridice de Restout : « la composition est grande, belle et une. On voit en haut Pluton [...] Proserpine est à côté de lui. Au dessous à droite deux des juges [...] plus bas Orphée et Euridice [...] voyez-vous comme tous ces objets tiennent et s'enchaînent ? » (p. 186 sq). Les nombreuses indications précises et les démonstratifs à valeur déictique contribuent à aider le lecteur à visualiser le tableau, à s'imaginer la toile. Dans le premier Salon, Diderot n'use pas beaucoup de ces procédés mais il développe un véritable scrupule technique dans les Salons suivants. Dans celui de 1761, voici comment il structure sa description d'un tableau de Greuze : « voilà l'ordonnance générale. Venons-en aux détails » (p.166). L'organisation du tableau, les détails nombreux sont au service d'une fidélité qui montre l'œuvre.
Cependant, Diderot ne se contente pas de morceaux de description objective et désincarnée. Sa désinvolture provient notamment de sa réappropriation de la notion d'« ekphrasis ». A l'origine, cet exercice de rhétorique dans l'Antiquité consistait à faire la description d'une œuvre d'art in absentia sur le mode de l'éloge. Diderot dépasse cette conception en mêlant l'ekphrasis au blâme. Il dépasse la dimension d'exercice rhétorique pour lui insuffler une vigueur plaisante. « Il ne faut point copier ou copier mieux » assène-t-il à Pierre après une longue critique de son Christ à la tête « livide et pourrie » (p.122). Il envoie plusieurs peintres au « Pont Notre Dame », lieu d'exposition de ce qu'il appelle des « croûtes » qui n'ont rien à faire dans les Salons. Mais il est aussi capable d'un réel enthousiasme. En témoigne l'éloge du portrait de Mme Greuze enceinte en 1763 (p.240), traité sur un mode de respect qui contraste avec la tonalité ironique qui animait en 1761 la description de Mme Greuze en vestale (p.156). Ainsi, Diderot renouvelle les codes de l'ekphrasis pour en faire un instrument d'éloge et de blâme.
La critique de Diderot n'est pourtant pas soumise à un seul souci d'objectivité : elle répond à une revendication de fantaisie et d'esquisse. Les Salons sont moins un rapport exhaustif des expositions qu'une promenade au gré des désirs du salonnier. Diderot fait des choix ; en 1759, il reste extrêmement laconique sur les peintres qu'il n'apprécie pas. Il n'a par exemple aucun souvenir de Challe et s'excuse auprès de Grimm en arguant de l'« inadvertance [avec laquelle] on passe devant les compositions médiocres » (p.97). A la fin du Salon de 1761, il confesse qu'il y a peut-être d'autres tableaux intéressants dont il ne parle pas mais s'il ne s'en souvient pas « c'est qu'ils ont été muets et qu'ils ne m'ont rien dit » (p.162). Cette promenade est rythmée par des coups de cœur, des enthousiasmes variés. Il s'agit de ne pas être « froid » comme il le signale dans les Essais (p.78) : « le plaisir s'accroîtra à proportion de l'imagination de la sensibilité et des connaissances. La nature et l'art qui la copie ne disent rien à l'homme stupide et froid. »
Diderot n'est jamais froid, mais toujours piquant, même lorsqu'il n'aime pas. Sa critique est notamment nourrie d'humour et d'ironie, sources de connivence avec le lecteur. Sa fantaisie passe par un jeu constant avec les attentes du lecteur. Dans le Salon de 1761, il esquisse un éloge des Bergeries de boucher : « Quelles couleurs ! Quelle variété ! [...] cet homme a tout » mais il rompt l'énoncé élogieux par une chute ironique : « cet homme a tout, excepté la vérité » (p.119). Cet effet d'attente trompée, appelée également paryponoïan, est récurrent dans les Salons, comme dans celui de 1759 lorsque Diderot, s'adressant à Grimm, s'exclame à propos d'un tableau de Carle Van Loo : « enfin, nous l'avons vu ce fameux tableau de Jason et Médée. O mon ami, la mauvaise chose ! » (p.91) . Les blâmes qu'il formule ne sont pas froids mais plaisants. Ainsi de l'humour avec lequel il évoque le Christ « à l'air benêt » de La Piscine Miraculeuse de Vien : « et que ma Sophie a raison quand elle dit que s'il est malade il faut que ce soit d'un cor au pied » (p.95). Il y a un décalage burlesque à évoquer le Christ en imaginant qu'il souffre d'un mal bénin par comparaison à la souffrance subie lors de la Passion. Dans les Essais, il pratique également une prose pleine d'humour. Les titres (« Mes pensées bizarres sur le dessin », « Paragraphe sur ma composition où j'espère que j'en parlerai »...) rappellent à bien des égards l'esprit ludique des romans libertins du XVIIIème ou des romans comiques du XVIIème.
La critique d'art diderotienne se fonde donc sur la description fidèle des œuvres. Mais Diderot détourne l'usage rhétorique traditionnel de l'ekphrasis pour lui insuffler une subjectivité, une opinion personnelle capable de blâmer, une désinvolture de ton capable d'esquisser d'autres tableaux. La critique se trouve ainsi à l'image de la « description » telle qu'elle est définie au XVIIIème dans L'Encyclopédie, c'est-à-dire dans son opposition à la « définition ». La description n'avait alors pas la stabilité objective qu'on lui confère aujourd'hui. Elle était expression d'une subjectivité.
Une critique poétique
La critique d'art pose un problème d'ordre linguistique : comment rendre compte, par un langage verbal, d'œuvres artistiques ? Au sein des Salons, Diderot évoque les difficultés à rendre compte par des mots une œuvre picturale qui appartient à un autre univers sémiotique. Il s'interroge sur la manière d'évoquer la Bataille de Casanove (p.162) : « mais que vous dirai-je de sa Bataille. Il faut la voir. Comment rendre le mouvement, la mêlée, le tumulte d'hommes jetés confusément [...] comment peindre cet homme renversé. » Il confie également ses doutes à Grimm au début du Salon de 1763 :
Pour décrire un Salon à mon gré et au vôtre, savez-vous, mon ami, ce qu’il faudrait avoir ? Toutes les sortes de goût, un cœur sensible à tous les charmes, une âme susceptible d’une infinité d’enthousiasmes différents, une variété de style qui répondît à la variété des pinceaux; pouvoir être grand et voluptueux avec Deshays, simple et vrai avec Chardin, délicat avec Vien, pathétique avec Greuze, produire toutes les illusions possibles avec Vernet. Et dites-moi où est ce Vertumne-là ? Il faudrait aller jusque sur les bords du lac Léman pour le trouver peut-être (p.181)
Comment trouver un équivalent linguistique aux œuvres vues ? Tel est le problème auquel Diderot se heurte.
Malgré la gageure que cela représente, Diderot semble s'approcher à bien des moments de cet objectif. Reprochant à Boucher, en 1761, le désordre de sa composition et l'incongruité de ses figures, il énumère sans lien de coordination lesdites figures, sur plusieurs lignes, dans une phrase dont la syntaxe mime le désordre du tableau : « quel sujet a-t-on jamais rassemblé dans un même endroit, en pleine campagne, sous les arches d'un pont, loin de toute habitation, des femmes, des hommes, des enfants, des boeufs, des vaches, des moutons, des chiens, des bottes de paille, de l'eau, du feu, une lanterne, des réchauds... ». « Quel tapage d'objets disparates ! » finit-il par conclure comme pour rendre au lecteur, par une métaphore auditive, toute la dissonance visuelle du tableau (p.119).
A l'inverse, il emploie une syntaxe épurée pour rendre compte des natures mortes de Chardin, Le Bocal d'Olives ou La Raie dépouillée : « c'est la nature même », « O Chardin, ce n'est pas du blanc, du rouge du noir que tu broyes sur ta palette, c'est la substance même des objets » « c'est la chair même du poisson » (p.219sq). L'emploi des présentatifs (« c'est ») permet d'asserter un lien d'équivalence entre le tableau et ce qui est décrit.
Le dialogue constitue une étape décisive dans la critique diderotienne : le salonnier parle peut-être moins à la place de l'art qu'avec lui. La formule dialogique est constante chez lui, tant dans son œuvre littéraire (Le Neveu de Rameau, Jacques le Fataliste) que philosophique et artistique. Par cette forme non monologique, la critique fait advenir l'autre, qu'il soit le peintre, le lecteur (Grimm notamment) ou le tableau lui-même. Alors que les critiques non praticiens d'art sont, à l'époque où écrit Diderot, très peu appréciés (on juge que seuls les artistes peuvent juger de l'art), le dialogue avec les peintres permet d'adresser des critiques avec moins de radicalité et plus de sympathie. L'humour aidant, la satire, sans s'affadir, a un impact moins abrupt et s'inscrit dans le respect de l'artiste et de l'art. « Revenez à vos tulipes ! » dit-il par exemple à Bachelier en 1761. Il entame même un dialogue imaginaire avec Boucher, procédé, qu'il affirmera dans les Salons de 1765 et 1767. Il instaure également un dialogue avec l'œuvre elle-même : « Voilà le discours qu'il fallait que je lusse sur le visage d'Hérodiade » écrit-il à propos de la Décollation de Saint Jean de Pierre. Ou encore, il imagine ce que pensent les servantes jalouses du tableau de Greuze, Un Père qui dote sa fille (p.164) : « quand est-ce que notre tour viendra ? » ou le père qui semble dire au gendre : « Jeannette est douce et sage, elle fera ton bonheur ».
Les exemples de dialogues entamés avec le tableau abondent. La peinture cesse d'être considérée comme une poésie muette et devient parole en puissance, libérée par le critique. La peinture devient narrative et dialogique, elle appelle la projection du spectateur, comme lorsque Diderot interpelle la « Belle sainte » dans La Madeleine dans le désert de Carle Van Loo pour entrer avec elle dans la grotte (p.116) : « Belle sainte, venez ; entrons dans cette grotte et là nous nous rappellerons peut-être quelques moments de votre première vie ». Chez Diderot, le dialogue relève d'une posture éthique qui consiste à reconnaître à l'autre sa capacité à dire une vérité. Diderot, loin de parler à la place du tableau, le fait parler.
Mais l'art du critique ne s'achève pas dans cet échange : il consiste également à interroger les frontières entre création artistique, description de l'œuvre, et geste poétique. « Son pittor anch'io », Moi aussi je suis peintre : c'est par cette formule qu'il conclut l'une des plus belles pages du Salon de 1763 (p.225). Après quelques lignes de description du Paysage de Loutherbourg, Diderot invite le lecteur à entrer dans le tableau : « Que la nature est belle dans ce petit canton ! Arrêtons-nous y [...] couchons-nous le long de ces animaux. » L'entrée dans l'œuvre coïncide avec une entrée dans le langage poétique : on peut se risquer à lire deux vers blancs dans : « qui charme le silence de cette solitude et trompe les ennuis de sa condition » (deux alexandrins). Comme Baudelaire plus tard, lui aussi critique d'art, Diderot semble écrire un véritable poème en prose dont le sujet est une aventure champêtre. « L'objet peint n'est plus qu'un prétexte, mais où la poésie reproduit le travail créateur du peintre et le prolonge, ce qui équivaut à faire véritablement œuvre de critique » écrit Jacques Chouillet.
Imiter l'art pour rendre le Beau
Le lien entre le travail du critique et celui du peintre est à envisager dans un rapport analogique à celui qui unit l'art et la nature. C'est la question de l'Imitation qui est au cœur de leur préoccupation.
Artistes et critique partagent la même ambition : « savoir animer les choses mortes » (Essais). Devant lui, le critique a des objets d'art sans mouvement, sans vie (et le lecteur lui, n'a rien sous les yeux). Son travail consiste alors à les rendre vivants, de même que le peintre de nature morte doit savoir animer son tableau. Ce que Diderot appelle « la magie » de Chardin peut être lue comme la magie du critique d'art à « traduire » la toile à son tour. Comme le peintre d'histoire, le critique doit avoir des grandes qualités « pour contrebalancer la froideur, la monotonie et le dégoût de ces longues files parallèles de soldats » (écrit-il à propos de L'Enfant). Remplaçons « soldats » par « tableaux » et nous comprenons en quoi consiste le génie de Diderot. Comme le bon portraitiste, il ne fait pas des « portraits » uniquement ressemblants des tableaux qu'il voit, il essaie de rendre compte de l'Idée de l'œuvre, des principes qui l'animent : « tant que les portraitistes ne feront que des ressemblances, sans composition, j'en parlerai peu. Mais lorsqu'ils auront senti une fois que pour intéresser il faut une action, alors ils auront tout le talent de peintre d'histoire ». Le critique est une figure du portraitiste, il doit nous peindre le portrait d'un tableau et c'est moins un rapport de fidélité mimétique qui importe qu'une imitation, une traduction de l'Idée.
Faire œuvre de critique c'est également rompre les liens entre les frontières génériques et artistiques, c'est convoquer d'autres images c'est-à-dire d'autres œuvres, d'autres arts. Les Salons sont caractérisés par cette polyphonie générique, ils accueillent différents morceaux de la littérature. Dans le Salon de 1759, L'Assomption de La Grenée n'est pas réussie car le peintre n'a pas su exploiter « l'effet sublime du lieu de la scène ». Diderot fait alors la description d'un tableau imaginaire, libre variation de L'Enéide de Virgile : « si j'avais eu à peindre la descente de Vénus dans les forges de Lemnos, on aurait vu les forges en feu. [...] Le sujet était de poésie et d'imagination, et j'aurais tâché d'en montrer. Au lieu de cela, c'est une grande toile nue où quelques figures oisives et muettes se perdent. [...] M. La Grenée n'y a pas vu tant de difficultés; il était bien loin de soupçonner l'effet sublime du lieu de la scène. » Il renouvelle le procédé en 1761 avec Le Combat de Diomède et Enée de Doyen en relisant les vers de L'Iliade : « voilà si j'avais été peintre le tableau qu'Homère m'eût inspiré » (p.152). S'élabore alors un tableau en diptyque : celui, réel, de Doyen et celui, onirique, de Diderot qui aurait choisi le moment précédent : « cette composition est toute d'effroi. Le moment qui précédait la blessure eût offert le contraste du terrible et du délicat. »
Cette pratique du parallèle établi entre littérature et peinture est proche de celle du paragone dans l'Antiquité qui permet, par la comparaison, de faire advenir ressemblances et dissemblances entre les arts et de donner au tableau une profondeur artistique dans un siècle où l'art consiste moins à être original qu'à bien « imiter ». « La peinture est dans un tableau ce que le style est dans un morceau de littérature » (1761, p.134). Incapable d'expliquer avec des mots les sentiments qui se dégagent du Saint Victor de Deshays (lequel représente ce que Diderot a théorisé sous le concept de « modèle idéal »), il doit faire appel à des vers de Polyeucte de Corneille : « il y a des passions bien difficiles à rendre. Presque jamais on ne les as vues dans la nature. Où donc en est le modèle ? Où les peintre les trouve-t-il ? [...] Rappelons nous les vers que Corneille a mis dans la bouche de Polyeucte. Imaginons d'après ces vers la figure du fanatique qui les prononce et nous verrons le St victor de Deshays » (p.135). Le travail du critique consiste à établir le dialogue entre les arts : à cet égard, les Salons représentent un véritable creuset artistique.
Le texte appelle un hors texte, l'œuvre de Diderot abolit les frontières entre les arts, mais aussi, ultime désinvolture, les cadres du tableau, c'est-à-dire à abolir la limite entre l'art et le non art. André Malraux explique dans Le Musée Imaginaire que les cadres de tableaux avaient à l'origine pour fonction de marquer une délimitation entre le réel et la peinture, comme pour valoriser la vraisemblance et la vérité des œuvres, comme un garde fou chargé de montrer où est l'art. Diderot, en guise de preuve par la négative, propose, pour apprécier la beauté de l'œuvre de Vernet, de regarder les tableaux avec une lunette qui en masquerait les bords « et en oubliant tout à cou que vous examinez un morceau du peintre, vous vous écrierez : [...] Oh le beau point de vue ! ». Le génie de Diderot se révèle également dans sa capacité à nous faire percevoir le phénomène inverse : voir la nature comme une « toile magique » (Essais). Les tableaux ne sont pas simplement impossibles à différencier de la nature, ils sont aussi la source de la beauté de la nature. Dans une lettre datée de 1751 à Mlle de La Chaux, il écrit : « je suis sûr que jamais clair de lune ne vous a autant affecté dans la nature que dans une Nuit de Vernet » et dans les Essais il développe largement l'idée selon laquelle la nature « est le résultat de l'art et réciproquement ». Tout concourt à parler « autour » de l'art, de l'œuvre d'art, à faire refléter de multiples images qui visent à éduquer le goût du lecteur et à lui permettre de lieux lire l'art.
Si Diderot semble à certains moments se substituer à l'œuvre d'art, c'est précisément pour atteindre l'Idée de l'œuvre, que le sujet impose mais que le peintre a manqué. S'il évince un tableau raté c'est donc précisément pour atteindre l'Art. Ainsi, Diderot pose le problème d'un langage nécessaire à trouver : quelle écriture peut rendre compte du langage pictural ou sculptural ? Il esquisse une réponse : par une prose poétique, par l'animation des figures sur la toile, par le miroitement des images. Diderot se contente de révéler, par son écriture, les paroles qui émanent de l'œuvre et lorsqu'il passe sous silence certains tableaux, « c'est qu'ils sont muets et qu'ils ne [lui] ont rien dit ».